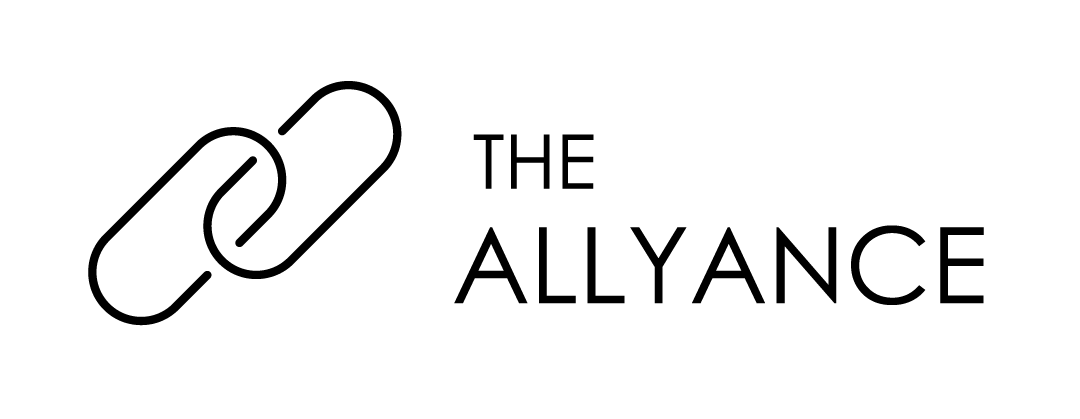10 questions à Gabrielle Deydier, autrice et militante anti-grossophobie
💖 The Allyance est votre expert diversité, inclusion et recrutement dans le domaine de la tech.
Depuis plusieurs années, Gabrielle Deydier travaille sur la grossophobie et a largement contribué à faire connaître cette discrimination. En 2017, Gabrielle a écrit “On ne naît pas grosse”. En 2020, Gabrielle Deydier a réalisé “On achève bien les gros” avec Laurent Follea et Valentine Oberti. Aujourd’hui, Gabrielle répond à 10 questions pour The Allyance !
———
The Allyance: Bonjour Gabrielle, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Gabrielle Deydier : Je m’appelle Gabrielle Deydier, j’ai la petite quarantaine. Je suis autrice et réalisatrice. Née à Nîmes, j’ai grandi à Uzès dans le Gard puis étudié le cinéma et les sciences politiques à Montpellier. Ce n’est qu’à l’âge de 35 ans que je suis arrivée à Paris ! Un peu ours, je passe ma vie avec mes livres… Et pour l’anecdote, j’ai commencé à écrire des “fan fictions” sous forme de roman à partir d’épisodes de Jeanne & Serge et Olive & Tom que je venais de regarder… On commence tous.tes quelque part !
Qu’est-ce que la grossophobie ?
😕 La grossophobie est un monstre à plusieurs têtes, et c’est là tout le problème. Ce terme désigne un ensemble de comportements de rejet et de discrimination envers les personnes grosses.
On pense souvent à la grossophobie du quotidien, ou grossophobie ordinaire : les insultes, les commentaires sur les corps gros, sur les paniers de courses des personnes grosses…
Mais il existe aussi une grossophobie plus systémique, tout d’abord intrinsèque au monde du travail, au sein duquel on a tellement intégré le rejet des gros.ses.
La troisième “tête” de ce monstre, c’est la discrimination dans le milieu médical, encore plus systémique puisque le.la gros.se n’existe tout simplement pas ! Aucun brassard de tension, fauteuil roulant, ambulance… ne lui est adapté ! En plus, les médecins souvent grossophobes préfèrent culpabiliser les gros.ses plutôt que de les accompagner. Le résultat : certain.es gros.ses refusent aujourd’hui de se soigner par peur de ces violences et négligences.
En plus de tout ça, on peut compter tous les impensés du quotidien : par exemple, si tout le monde a hâte que les théâtres rouvrent, moi je ne peux tout simplement pas y aller, car les sièges ne sont pas à ma taille !
👉 En fait, rien n’est pensé pour les gros.ses, car on s’est tout simplement dit qu’on allait les faire maigrir, avec des solutions et régimes au taux d’échec catastrophique de 95%. Je le dis et je le répète, on ne peut pas faire porter la faute aux gros.ses sans se remettre en question. Nous ne sommes pas des citoyen.nes de second rang ! Nous existons, les statistiques en attestent, même si je me demande ce que l’on fait de ces données…
Comment se caractérise la grossophobie au travail ?
👉🏼 Pour te répondre, je vais te donner un exemple concret. À l’issue de conversations assez dures avec d’ancien.nes camarades de promotion, je me suis rendue compte qu’ils avaient tous.tes trouvé un stage en envoyant 10 CV alors qu’après 300 envois, je n’en trouvais aucun… Pour eux, cela venait forcément de mon profil professionnel. Jamais, ils n’ont envisagé que j’étais défavorisée par mon physique.
Si j’en ai très peu parlé avant mon livre, c’est que dans un système gouverné par l’idéologie de méritocratie, ce sujet touche facilement l’égo des gens. Il n’empêche qu’à diplôme égal, une femme grosse a huit fois moins de chance d’être recrutée, et un homme gros trois fois moins de chance. On remarque aussi que les gros.ses sont moins bien payé.es, et ce notamment du fait de la nature de leurs emplois.
Pour parler de mon expérience, tout a commencé quand j’étais étudiante. Malgré ma confiance en moi, mon hyperactivité, il m’était impossible de trouver un stage, ou même un job d’été ou d’étudiante. Au Mac Donald’s, on m’a clairement dit que l’on ne pourrait pas m’embaucher pour ne pas faire peur aux clients en leur montrant ce qu’ils pourraient devenir en mangeant dans ce restaurant… Pour obtenir mon premier job étudiant à l’accueil d’une résidence étudiante, j’ai dû faire des pieds et des mains. La directrice redoutait que je m’en prenne plein la tête parce que je suis grosse. Elle a eu raison, je me suis pris pas mal de remarques… Mais au moins j’ai pu travailler ! Pour toutes ces raisons, je n’ai quasiment jamais eu de “job carrière”.
❌ De toutes les façons, une fois qu’un.e gros.se accède au poste, la grossophobie est toujours là. Les collègues sont violents. Par exemple, un collègue, en parlant de la réforme des retraites, s’est permis de dire que quoiqu’il en soit, je mourrais bien avant la retraite… Dans un registre plus grave, j’ai aussi été victime de harcèlement sexuel avec menace de viol, mais personne ne m’a crue. Il paraissait impossible que cet homme harcèle sexuellement une femme grosse, jugée a fortiori beaucoup moins belle que sa femme.
En général, une personne grosse doit toujours en faire plus pour arriver au même résultat que quelqu’un qui ne l’est pas. Il m’est déjà arrivé de faire plus que ce qui correspondait à ma fiche de poste pour compenser et montrer que j’étais compétente, que l’on n’avait pas fait d’erreur de recrutement. C’est véritablement le syndrome du bon élève : on veut se rendre indispensable.
❌ En termes de carrière, les gros.ses occupent rarement des postes cadres, notamment car elles et ils font moins d’études que les autres. De toutes les façons, plus tu as été gros.se jeune, plus tu as assimilé qu’il était normal d’être mis de côté...
On parle souvent de grossophobie médicale pour décrire les discriminations subies lors d’échanges avec les professionnels de la médecine, qu’en est-il de la médecine du travail ?
▶️ Les rares retours que j’ai pu avoir sur la médecine du travail ont été très mitigés voire négatifs. On demande toujours aux gros.ses de maigrir. Voilà pourquoi un.e gros.se aura toujours une certaine angoisse à l’idée d’un rendez-vous avec la médecine du travail. Pour moi, elle ne remplit pas son rôle dans sa prise en charge des personnes gros.ses, surtout si l’on compare cette prise en charge avec celle des personnes non grosses. S’il y avait une vraie prise en considération politique des corps gros dans le monde professionnel, on pourrait sûrement travailler cette question.
Comment pour faire changer les choses quand on parle de grossophobie au travail et de discriminations liées au poids ?
Aujourd’hui, l’Observatoire des Discriminations, et notamment Arnaud Alessandrin, fait un super travail. Cependant, je rêve d’un audit national sur les gros.ses au travail, d’une méta-enquête de données, dans laquelle on aborderait de nombreuses thématiques…
On pourrait aussi imaginer une campagne sur la grossophobie au travail, ainsi que la création d’une vraie cellule qui prouve que ce sujet est pris au sérieux, avec notamment pour but d’informer les gens sur leurs droits. Beaucoup de gros.ses vivent déjà dans la culpabilité d’être gros, c’est pourquoi il faut les aider à prendre la parole.
En septembre 2017, Gabrielle Deydier fait la Une de The Observer.
Comment les entreprises peuvent-elles être plus inclusives à l’égard des personnes grosses ?
Pour commencer par la pratique, lorsque le poste est sédentaire, de simples questions d’ergonomie doivent se poser : acheter une chaise adaptée, réaménager l’espace… Mais la réalité, c’est que les femmes grosses qui travaillent font des jobs physiques et sont très souvent non cadres !
Il est impératif de revoir la façon dont on recrute en France, de dépoussiérer ces méthodes RH complètement has been et discriminantes. Il faut s’habituer à voir les gros.ses dans le monde du travail, à les connaître, et arrêter de dire que certains postes ne sont pas faits pour les gros.ses.
Si une personne est discriminée en raison de son apparence physique, quels sont les recours possibles ?
📗 En théorie, on peut porter plainte, s’adresser au Défenseur des droits, à l’Inspection du travail ou à une organisation syndicale.
En pratique, la réalité est toute autre : en visite dans un cabinet d’avocats spécialisé dans les discriminations au travail, on m’a expliqué qu’une plainte pour grossophobie était une bouteille à la mer. En fait, il est difficile d’être cru.e et entendu.e, en plus de ne pas vouloir perdre son emploi dans un système qui n’embauche pas les gros.ses.
Il n’empêche que si vous en avez le courage, adressez-vous aux institutions qui peuvent vous aider : il faut que ce sujet ne soit pas passé sous silence, que cela sorte, que les structures soient habituées à prendre en charge ce genre de cas. Il n’y a pas de raison que l’on laisse croire aux agresseur.ses qu’ils.elles ont le pouvoir de nous diminuer en toute impunité.
Depuis plusieurs années, tu travailles sur la grossophobie. La situation a-t-elle évolué depuis la sortie de ton livre il y a 4 ans ?
En 4 ans, je pense que j’ai au moins atteint mon but, c’est-à-dire faire parler à savoir que l’on parle de grossophobie. En 2019, le mot est même entré dans le dictionnaire ! En général, on voit maintenant de plus en plus de prises de parole, de documentaires sur le sujet. Les médias ont intégré la grossophobie quand ils parlent des différents types de la question aux discriminations. Ils reçoivent des gros.ses, on leur posent des questions… La mairie de Paris a même organisé deux journées anti-grossophobie ces dernières années. Les écoles ne demandent qu’à en discuter de cette notion pour les l’intégrer aux formations programmes scolaires sur les discriminations.
Campagne sensibilisation réalisée par la Mairie de Paris
💡 Pourtant, j’ai l’impression que l’on entend toujours un peu les mêmes gens, qui sont souvent actifs dans des groupes militants, notamment des groupes féministes. Cela reste ciblé sur les gens qui en parlent, dans les milieux féministes, ou ceux au sein desquels on aborde des questions de société. Concrètement, sur la diversité des prises de paroles, je ne vois pas beaucoup de changement. Évidemment, je comprends bien que tout ne soit pas au point tout de suite puisque l’on n’avait a jamais pensé aux gros.ses auparavant. Je vois aussi le fatwashing… (c’est-à-dire la mise en avant, creuse et opportuniste, des gros.sses) mais il a quand même pour avantage de nous rendre les gros.ses visibles, et c’est déjà ça.
Existe-t-il des associations qui permettent aux victimes de grossophobie d’être soutenues ?
🔗 Malheureusement, les associations qui aident les personnes grosses sont aussi invisibles que les personnes grosses elles-mêmes. Personnellement, je ne me suis jamais mise en retrait bien que j’aie dû serrer les dents. Je n’ai jamais pensé à aller dans une association de personnes grosses pour en parler, car j’ai eu la chance d’être très bien entourée en plus d’avoir le contact facile.
Pour celles et ceux qui n’ont pas cette chance, je trouve que les associations sont trop discrètes, donc je ne saurais pas vraiment où les envoyer. Il existe cependant des groupes sur l’espace médiatique, comme Gras Politique.
Aurais-tu des études ou des livres à conseiller à une personne s’intéressant à la grossophobie? En plus de ton livre bien sûr !
📌 Pour débuter, je recommanderais “Gros n’est pas un gros mot” de Gras Politique, rédigé sous forme de manifeste. Ce texte comporte des témoignages concrets et donne une vision assez globale de la grossophobie. J’ai adoré “Grosse, et puis ?” de la québécoise Edith Bernier, que j’ai trouvé très précis car bourré de références (québécoises).
Sur le sujet un peu plus tabou de la grossophobie envers les hommes, Mickaël Bergeron a écrit “La vie en gros”. Le témoignage “Hunger” de Roxane Gay permet aussi d’avoir une vision très globale dans un paysage états-unien. Enfin, je recommande chaudement l’étude de Jean-François Amadieu intitulée “La société du paraître”.
———
AUTRICE
✒️ “Je m’appelle Léa Chemardin. J’ai rejoint The Allyance dès sa création, un an et demi après ma rencontre avec Caroline, au concert de ionnalee ! Je suis traductrice et rédactrice de contenu freelance, surtout en langues française et anglaise, mais aussi en espagnol et allemand, que je parle couramment. Il se trouve que j’exerce également les fonctions d’employée administrative dans le secteur de la santé et de la science des données, finalement non loin du sujet de prédilection de Caroline. Du côté militant, j’ai de nombreuses occupations bénévoles dans des associations traitant de thématiques sociales et environnementales, au sein desquelles j’essaie toujours de mettre l’intersectionnalité et la convergence des luttes au centre, car je suis persuadée que toutes les causes sont interconnectées.”